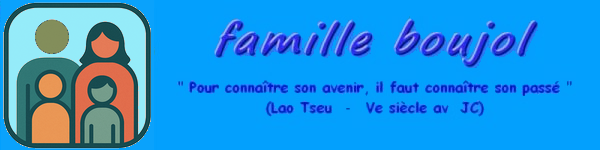Moïse Zumero, un mamelouk à Lavaur
On peut voir au cimetière du Port d’En Taïx à Lavaur une tombe peu commune, celle de Moïse Zumero, décédé à Lavaur le 9 mai 1873 à l’âge de 82 ans.
Comment ce personnage dont l’inscription figurant sur la pierre tombale nous précise qu’il était « Le dernier des Mamelucks né à St Jean d’Acre Syrie Chevalier de la Légion d’honneur », est-il venu finir ses jours dans le Tarn ?
Nous allons nous laisser guider par Madame Thérèse Blondel-Avron (1) qui a publié Moïse Zumero, Dernier Mamelouk de la Garde impériale aux Éditions Cabédita à Bière et un article sur le site napoleon-histoire.com auxquels nous empruntons les illustrations de la présente page, à l’exception du tableau « Charge des mamelouks lors du dos de Mayo à Madrid » par Jacques Onfroy de Bréville.
Moïse Zumero est né à Saint-Jean d’Acre en Syrie, le 14 avril 1791. Sa famille étant catholique orthodoxe grecque, il est baptisé le 2 mai dans l’église Saint-André de cette ville selon la transcription de son acte de baptême.
Son nom est Moussa Z’mero Al’Coussa, issu d’une famille patricienne dont plusieurs membres occupèrent des fonctions importantes. Son père possédait une entreprise prospère à Saint-Jean d’Acre. Persécutée par Ahmed Pacha, surnommé D’jezzar (« le boucher ») pour sa cruauté, la famille dut tout abandonner et s’installa à Jaffa.
Le général Bonaparte et son armée ont débarqué le 1er juillet 1798 [13 messidor An VI] à Alexandrie. Au début de 1799, Bonaparte décide de remonter vers la Syrie. Le 7 mars 1799, il investit la ville de Jaffa dans laquelle Abdallah, pacha de Damas, s’est réfugié avec son armée et ses mamelouks. La garnison fut passée au fil de l’épée mais des innocents furent également victimes, dont la mère, la sœur et deux frères de Moussa (2).
Malgré cela le jeune Moussa, qui n’a que huit ans, décide de rejoindre l’armée française au Caire, peut-être pour ne pas retomber entre les mains du cruel D’jezzar. Il est officiellement incorporé le 4 mai 1799 (3) comme trompette dans le corps des mamelouks de la garde consulaire. C’est à cette occasion que son nom est « simplifié » : il s’appellera désormais Moïse Zumero.
Après la victoire d’Aboukir du 25 juillet 1799, Bonaparte embarque précipitamment pour rentrer à Paris, laissant le gros de l’armée sous les ordres de Kléber.
Moïse Zumero fait son apprentissage de trompette, fonction importante car seul moyen de communiquer les ordres de l’état-major aux troupes par différentes sonneries.
Après l’assassinat de Kléber le 14 juin 1800 au Caire, l’armée rentre en France, y compris nombre de mamelouks et leurs familles, dont Moïse, qui a alors neuf ans, et son père.
Bonaparte qui voit dans ces « valeureux coupeurs de têtes au sabre » l’occasion d’accroître son prestige et d’étoffer la cavalerie de la garde, confit au général Rapp le soin d’organiser « l’escadron des mamelouks de la garde du premier consul ». Un arrêté du 15 avril 1802 [25 germinal An X] organise le corps des mamelouks. La solde annuelle d’un trompette est de 650 francs. Il a droit en plus à un cheval.
Zumero est envoyé au camp de Boulogne où se prépare l’invasion de l’Angleterre. Le camp sera levé en août 1805 pour gagner l’Allemagne face à la Troisième Coalition qui se terminera par la bataille d’Austerlitz le 2 décembre 1805. Mais Zumero ne sera pas à Austerlitz, il avait été licencié car trop jeune en septembre 1804.
Il réussira à se faire engager le 10 octobre 1808 dans la cavalerie de la Garde impériale et partira en Espagne où il servira jusqu’en 1812. Le 29 décembre 1808 il est blessé d’un coup de sabre au front et est proposé pour la Croix de la Légion d’Honneur qui lui sera décernée en… 1854 !
Entre deux campagnes, il réside à Melun, lieu de garnison des mamelouks. En 1812, c’est la campagne de Russie. Zumero est à Moscou. Lors de la retraite les mamelouks terrifient les Russes qui reculent. Le passage de la Berezina est terrible, Zumero a les pieds gelés et perd la majeure partie de ses orteils ce qui ne l’empêchera pas de remonter à cheval et de participer aux campagnes d’Allemagne en 1813 où il se distingue en délivrant son lieutenant prisonnier de trois hussards prussiens, et de France en 1814 où il est blessé au bras gauche le 31 mars 1814.
Le 10 mai 1814, il reçoit les galons de brigadier. Puis sa dernière bataille à Waterloo avant sa radiation de l’armée le 17 juillet 1815, comme « déserteur avec armes et bagages ». Il habitait à Paris et correspondait avec les autorités mais était victime de la vindicte populaire et administrative envers les anciens Bonapartistes après la seconde abdication de Napoléon. Ceci clôt une partie de sa vie et le début « d’une traversée du désert ». Il a 24 ans et doit se construire une nouvelle vie.
Mais il y a tout de même de bons côtés. Le 2 avril 1816, il épouse Anne Grenade Gaucher. La cérémonie a lieu à l’église Saint-Roch à Paris où officie son cousin Youssef Sabbagh, vicaire de la paroisse et aumônier des mamelouks.
Avec le retour de Louis XVIII, la pension de Zumero a été réduite de 1440 francs à 1080 francs. Il devra attendre 1825 pour, avec l’appui du chirurgien Larrey qui l’avait amputé à la Bérézina et de plusieurs autres personnalités dont le comte de La Tour-Maubourg, entrer dans l’administration des Postes. Il a 34 ans et commence une nouvelle carrière.
Sa première affectation a lieu à Mormant en Seine-et-Marne. Il bénéficiait ainsi de sa pension militaire et de son traitement de directeur des postes.
Le 21 mai 1832, il est nommé directeur des postes à Lavaur dans le Tarn. Il est logé dans l’hôtel de Berne et bénéficie d’un costume de drap avec des broderies au collet et aux manches comme le montre un portrait de l’époque.
Mais l’administration militaire de Toulouse lui refuse soudain le cumul de sa pension avec son traitement civil, comme cela était pourtant le cas de très nombreux mamelouks survivants. La polémique durera dix ans malgré l’appui du préfet du Tarn. Ce n’est qu’en octobre 1842 qu’il obtient enfin gain de cause.
En 1844, il est nommé à Chalet en Maine-et-Loire. Puis à Lorient dans le Morbihan. Lors de sa retraite, il choisit de revenir à Lavaur.
Sa santé se détériorait, il avait perdu l’usage de ses pieds amputés lors du passage de la Bérézina en 1812.
Il s’éteint le 9 mai 1873 entouré des siens, à l’âge de quatre-vingt-deux ans. Le 11 mai, la municipalité lui rendit les honneurs.
La Société Archéologique de Lavaur et les Amis du Musée lui ont consacré un fascicule à l’occasion de la Journée du Souvenir Napoléonien de 2019.
______________________________________________________________
(1) Elle est décédée le 5 janvier 2020.
(2) Sa famille, catholique orthodoxe grecque, avait tenu des postes importants dans l’administration. Elle avait dû s’exiler à Jaffa car persécutée par Ahmed Pacha, surnommé D’jezzar, c’est-à-dire « le boucher ».
(3) Les documents militaires indiquent qu’il est né le 12 juin 1789 à Saint-Jean d’Acre, en contradiction avec son acte de baptême. Sans doute a-t-il donné une date fausse pour être engagé car il n’a réellement que 10 ans.